Les oiseaux de mer canadiens aident à lutter contre la pollution microplastique
Les Oiseaux De Mer Canadiens Aident À Lutter Contre La Pollution Microplastique
Environnement et Changement Climatique Canada utilisent des espèces indicatrices telles que le fulmar pour surveiller l’évolution de la pollution microplastique
Il y a 15 ans, en 2007, Dre Jennifer Provencher étudiait les changements des régimes alimentaires des oiseaux de mer arctiques lorsqu’elle découvrit quelque chose de plutôt inhabituel : la présence de morceaux de plastiques dans leurs estomacs. «Ce fut une révélation pour moi et, par la suite, j’ai commencé à me pencher sur la question des plastique,» se souvient Dre Provencher.
Cette découverte va la mener vers la Hollande où les fulmars étaient déjà contrôlés pour leur ingestion de plastique.
«La mer du Nord est le seul endroit où le contrôle et le suivi de la pollution plastique est légiférée et ce sont les fulmars que l’on utilise pour cela.»
«La mer du Nord est le seul endroit où le contrôle et le suivi de la pollution plastique est légiférée et ce sont les fulmars que l’on utilise pour cela.»
Aujourd’hui, Dre Provencher et son équipe de l’Écotoxicologie et Santé de la faune, une division d’Environnement et Changement Climatique Canada, analyse le contenu des estomacs des fulmars au Canada afin de contrôler les niveaux de pollution plastique et comment ceux-ci répondent aux changements des politiques qui les régissent.
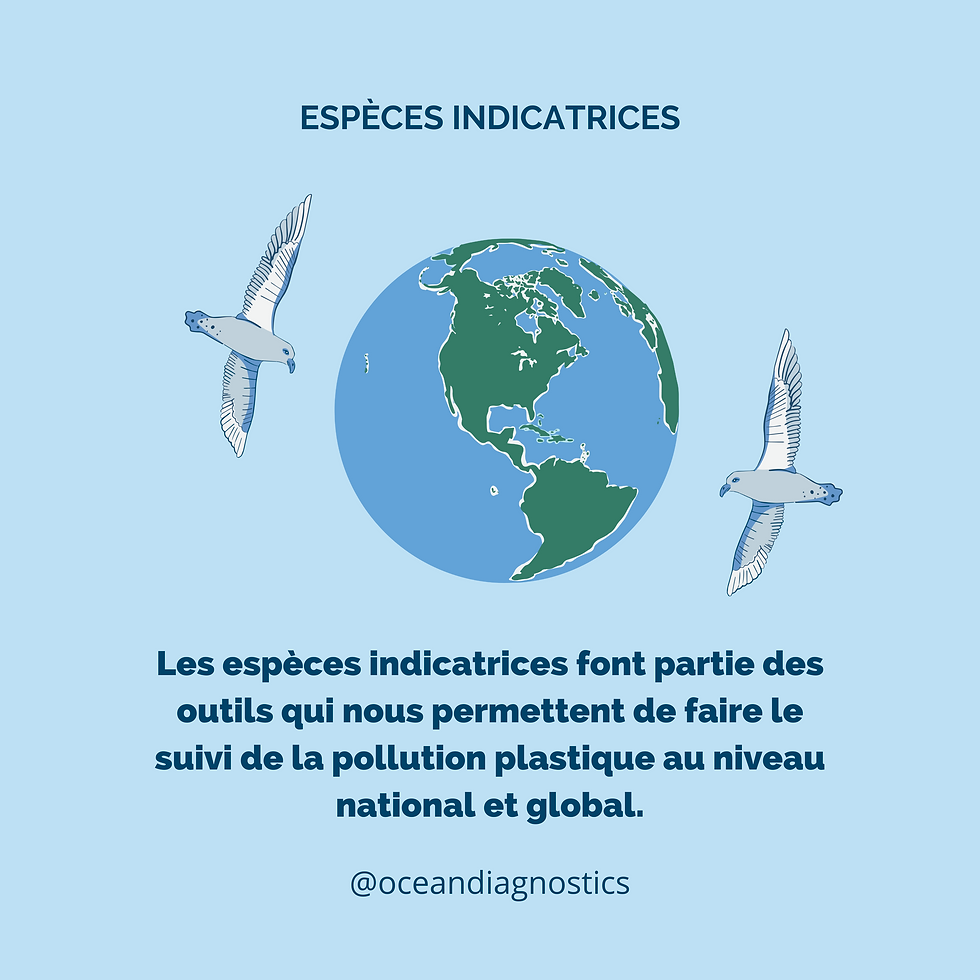
Qu’est-ce que le fulmar boréal?

Les microplastiques sont des particules plastiques dont la taille mesure 5 mm ou moins. Ils peuvent être ingérés par la faune, provoquant ainsi l’écoulement possible de produits chimiques associés ou rattachés à ces plastiques. Ils n’ont aucune valeur nutritive lorsqu’ils sont ingérés, et ils donnent l’illusion à l’animal que son estomac est plein.
Le fulmar boréal appartient à la catégorie des espèces indicatrices, autrement dit, cet oiseau nous permet de mesurer le niveau de pollution microplastique les zones où il s’alimente
Les fulmars boréaux sont connus pour leur ingestion et accumulation de plastique dans leurs estomacs. En fait, il s’avère qu’ils ingèrent plus de plastiques que les autres oiseaux de mer, les mammifères ou encore les poissons. Ils se nourrissent principalement à la surface de l’eau où le plastique a tendance à flotter, ainsi que dans ces tourbillons océaniques, appelés gyres, où le courant récolte et capture des plastiques dont l’accumulation est telle qu’elle forme de vastes étendues telles que le grand vortex du Pacifique Nord (Great Pacific Garbage Patch).
Les fulmars sont d’excellentes espèces indicatrices pour le contrôle de la pollution plastique :
-
Leur zone d’alimentation est limitée à la surface de l’eau, autrement dit là où le plastique flotte.
-
En couvrant des zones qui s’étendent à environ 10 000km, leurs habitudes alimentaires quotidiennes nous donnent à elles seules un large échantillonnage des différents plastiques présents.
-
Puisque les fulmars résident en Arctique, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les scientifiques peuvent ainsi comparer la pollution plastique de ces différentes régions nordiques. Cette comparaison a un poids déterminant pour évaluer l’efficacité des politiques mises en place à chacun de ces endroits.
«En récoltant différents échantillons d’eau, nous pouvons obtenir une mesure qui correspond précisément à un lieu et à un temps donné, ce qui est particulièrement intéressant pour répondre à certaines questions,» explique Dre Provencher. Même lorsqu’on cherche à avoir une vue plus globale de la pollution plastique, «ces oiseaux vont essentiellement se rendre à un endroit et effectuer d’eux-mêmes l’échantillonnage de la surface de l’eau.» Et c’est justement ce qui en fait de formidables espèces indicatrices.
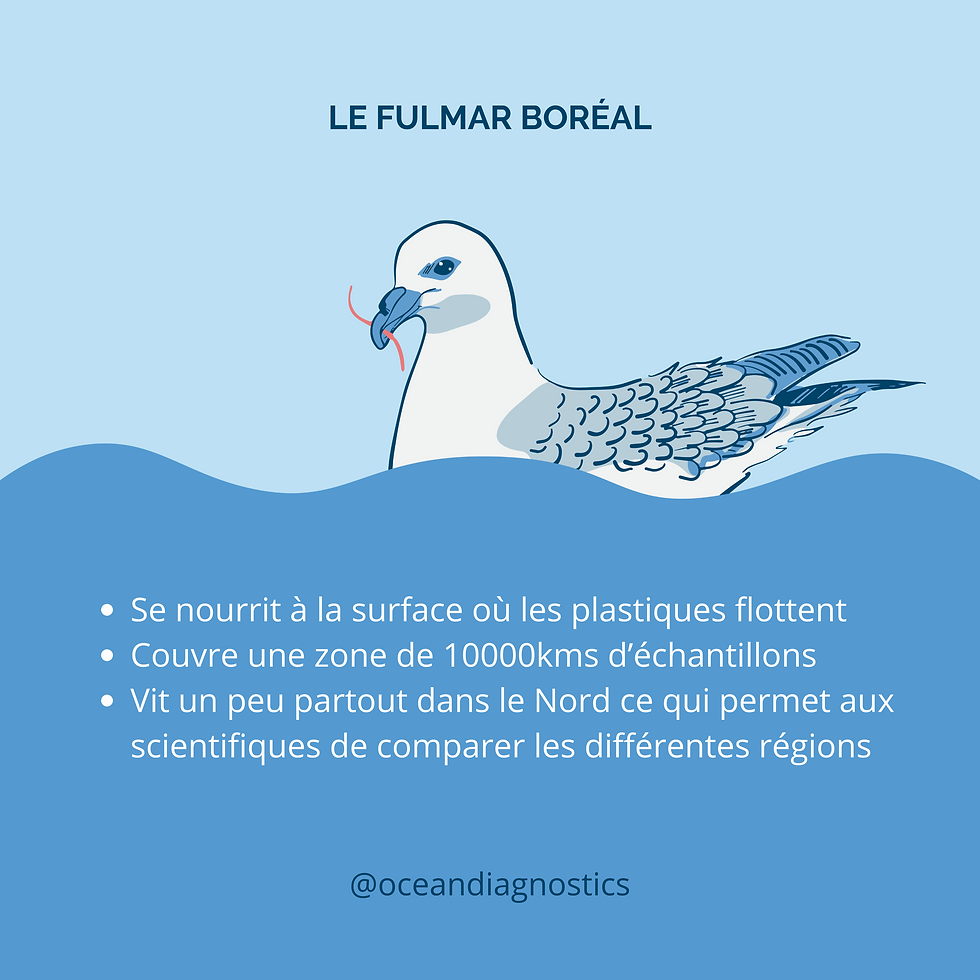
«Les fulmars représentent un outil parmi les nombreux outils de contrôle à notre disposition,» explique Dre Provencher
En raison de la diversité de la pollution plastique, il est très difficile de choisir un indicateur plutôt qu’un autre. Lorsqu’on parle de pollution plastique et microplastique, il faut aussi parler, entre autres, de taille, des différents types de polymères, des additifs, etc.
Le choix de l’espèce indicatrice dépend donc largement des questions de recherche auxquelles on souhaite répondre. «Par exemple, si l’on veut se pencher sur l’impact de la pollution plastique sur la santé humaine, on va plutôt choisir une espèce qui est consommée par les humains,» explique Dre Provencher.
L’objectif est donc de commencer avec une question et de créer ensuite les programmes de contrôle en fonction.
Une approche qui privilégie la réduction globale des risques donne une plus grande chance de survie à ces espèces
«La pollution plastique, c’est avant toute chose l’histoire d’un produit qui se retrouve perdu dans notre environnement. Et ça, c'est un énorme problème. Il est impératif de le réguler pour la bonne et simple raison que la pollution plastique n'est bonne pour personne,» déclare Dre Provencher.
Par où commencer et où mettre la priorité, c'est là toute la difficulté. Sur quel produit plastique, quel type ou quel additif le gouvernement doit-il se concentrer en premier ?
De plus, lorsqu’on sait que des substances chimiques s’écoulent des microplastiques et que les animaux qui les consomment se remplissent l'estomac sans pour autant bénéficier de valeurs nutritives, on comprend bien que les microplastiques eux-mêmes ne représentent pas un seul, mais bien plusieurs problèmes à la fois.
«La menace des microplastiques sur les fulmars est un problème à plusieurs facettes. Le plastique est loin d’être notre seul souci,» explique-t-elle.
En effet, même si les fulmars consomment des plastiques depuis plusieurs décennies, ils combattent également d'autres sources de stress comme la pêche accidentelle ou encore les changements des états de la glace dans les mers.
«Dans un monde qui cumule les menaces environnementales,» explique Dre Provencher, «nous devons avoir une approche beaucoup plus cumulative.»

Pour ce faire, Dre Provencher a choisi une approche qui privilégie la réduction des risques. «Si l'on s'inspire de l'approche du travail social, la réduction des risques consiste à gérer et à supprimer tous les éléments externes qui peuvent causer des dommages afin que la population soit protégée,» dit-elle.
Il s'agit de gérer les contaminants et de se concentrer sur leur réduction pour la bonne et simple raison qu’il y a d'autres facteurs de risque qui restent plus compliqués à gérer.
Cet ajustement des priorités pour mieux gérer les problèmes environnementaux est constamment au cœur de la préoccupation de bien des groupes de recherche gouvernementaux
«C'est un peu comme si on se tenait sur des sables mouvants.» – Dre Provencher
«Cette approche basée sur des faits et qui détermine ce qui doit être privilégié est un processus itératif », explique Dre Provencher, «et c'est exactement comme si nous nous tenions sur des sables mouvants.»
Pour comprendre quelles sont ses priorités, il est essentiel d'être toujours au fait des nouvelles sciences. Par exemple, comme le remarque Dre Provencher, les plastiques dans les biosolides, utilisés dans les champs agricoles, n'étaient même pas sur les radars des scientifiques il y a cinq ans. Aujourd'hui, ils sont une priorité.
Au sein du gouvernement, il y a généralement 2 types de groupes scientifiques : les groupes qui gèrent les politiques et ceux qui gèrent les directives de recherche.
Le groupe qui gère les différentes politiques reçoit des données provenant des groupes de recherche et présente les nouveautés dans des conférences. Après les conférences, ils partagent les nouvelles idées et les priorités avec le groupe de recherche.
Le groupe de recherche reçoit alors les commentaires, les priorités et les nouveautés qui ont été discutés avec le groupe des polices lors des conférences, ce qui leur permet de conduire d'autres recherches.
Au cœur de cet aller-retour, des oiseaux indicateurs tels que le fulmar deviennent alors des outils idéaux pour traquer l'évolution de la pollution plastique et permettre de prendre des décisions appropriées.
Lorsque le public exprime son inquiétude, cela a un impact sur les politiques, qui elles-mêmes influencent la direction que vont prendre les recherches gouvernementales
Le public joue un rôle essentiel dans le développement des politiques et des lois et il est évident que les inquiétudes exprimées ont influencé les politiques environnementales nationales et internationales.
En votant, en consommant différemment (par exemple en achetant moins de produits en plastique) et en prenant des décisions éclairées basées sur des faits, le public peut indéniablement influencer les politiques environnementales. Par exemple, les scientifiques comme le public, peuvent utiliser des preuves fournies par l'analyse du plastique ingéré par le fulmar boréal pour informer ceux qui prennent les décisions environnementales.
Grâce à des décisions politiques basées sur des informations concrètes et scientifiques, nous pourrons peut-être un jour acheter des produits sans nous inquiéter s'ils finiront dans l'estomac de l'un de nos oiseaux de mer canadiens
Même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, la Dre Provencher reste optimiste quant aux générations futures. Alors qu'elle se promenait dans l'une des allées d’un supermarché, sa fille réclama une boisson gazeuse. La Dre Provencher lui expliqua alors qu’elle trouvait régulièrement des capuchons en plastique de ces mêmes bouteilles dans les estomacs des oiseaux de mer. Depuis, chaque fois qu'elle et sa fille se trouvent dans un supermarché, visa fille demande (à voix bien haute) «maman, est-ce que tu trouves toujours des capuchons en plastique dans les ventres des oiseaux ?!» Sa fille a même eu la conversation avec des inconnus qui achetaient des bouteilles en plastique. Aujourd'hui, elle sait où finissent les plastiques et elle n'a plus aucune envie d'en acheter.
La Dre Provencher espère qu'un jour nous cesserons de découvrir des capuchons en plastique dans les estomacs des oiseaux et que le plastique demeurera au sein de l'économie et non pas perdu au milieu de l'environnement. Mais d'ici là, elle va continuer à surveiller de près les espèces indicatrices.
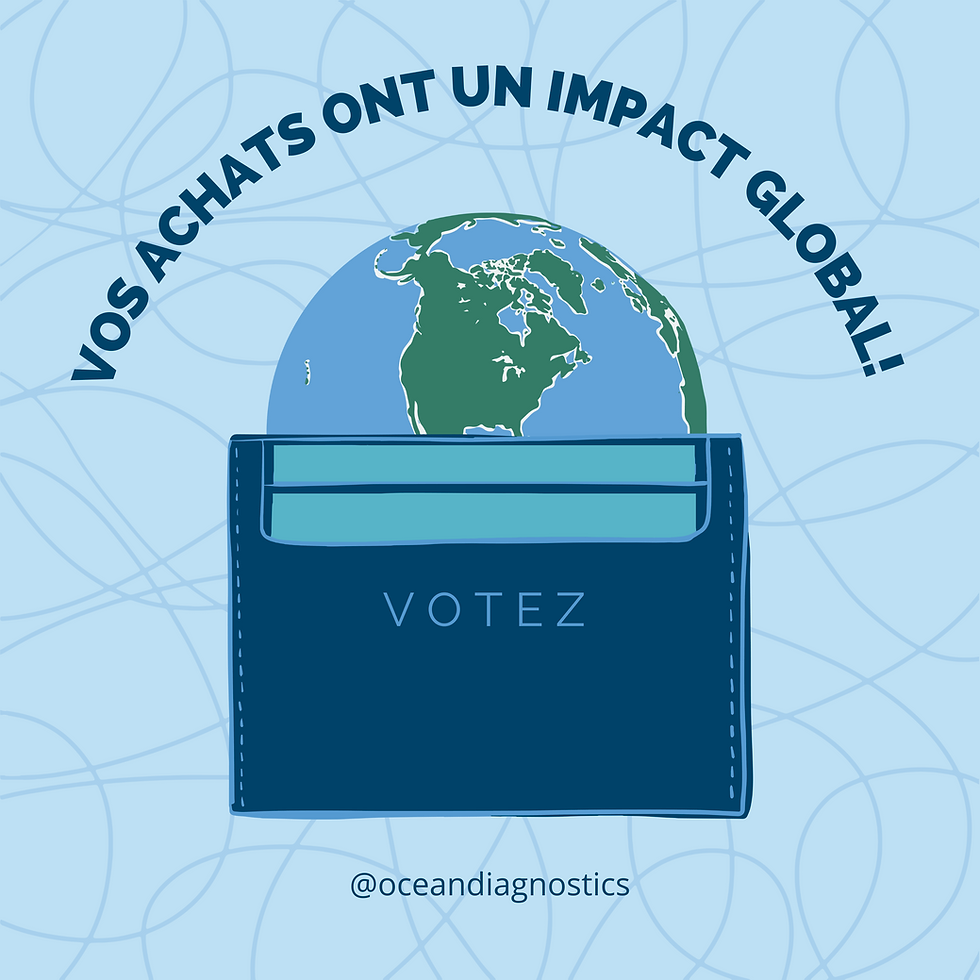
Ocean Diagnostics Inc is an environmental impact company that develops technologies and laboratory capabilities to standardize microplastics data collection and analysis. The company works closely with academic and government partners to advance microplastic science. ODI has partnered with Environment and Climate Change Canada to share information on plastic pollution from Canadian plastic experts. Learn more here.
Follow #BeatPlasticPollution for the latest news.
